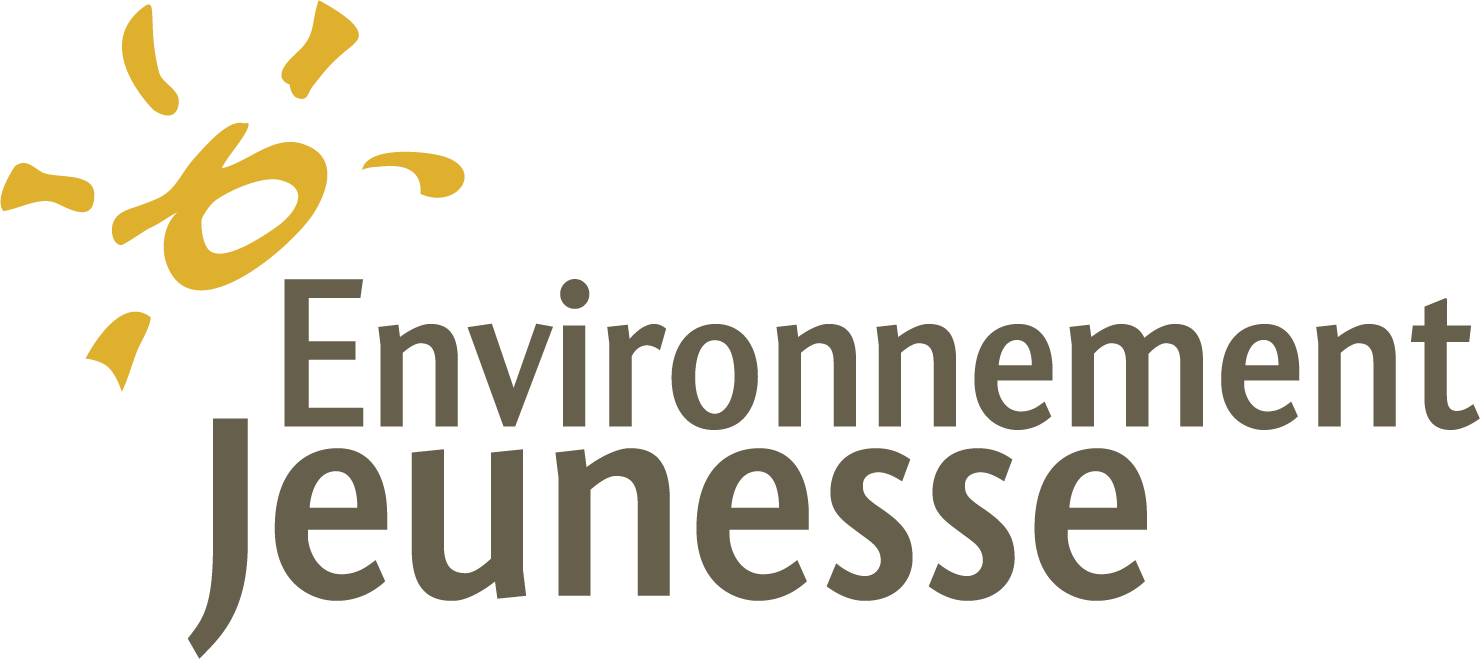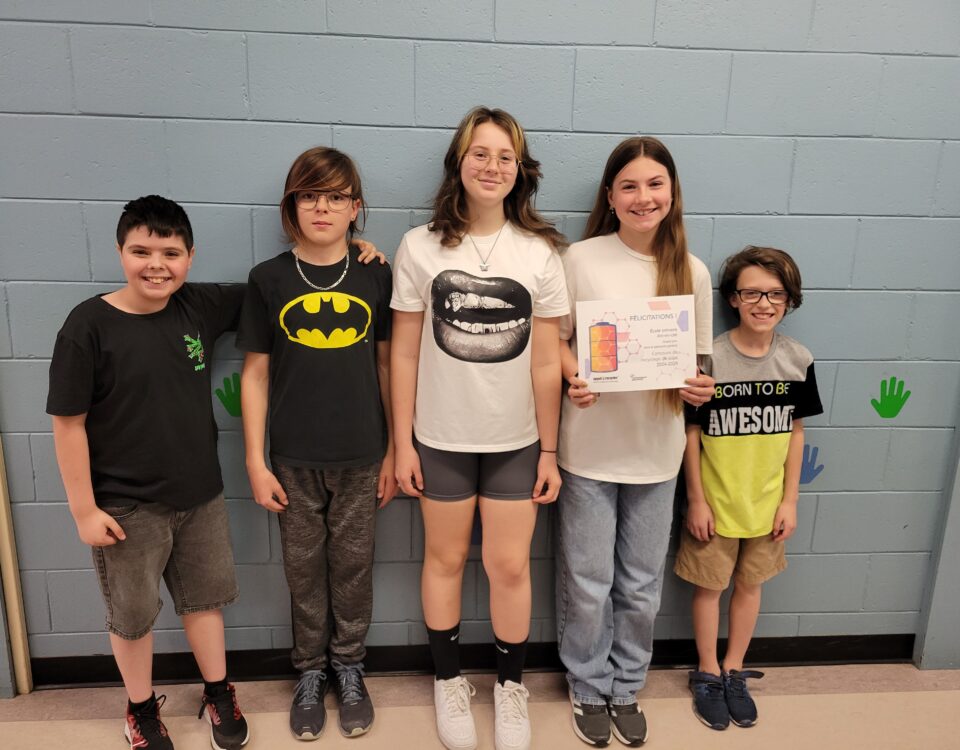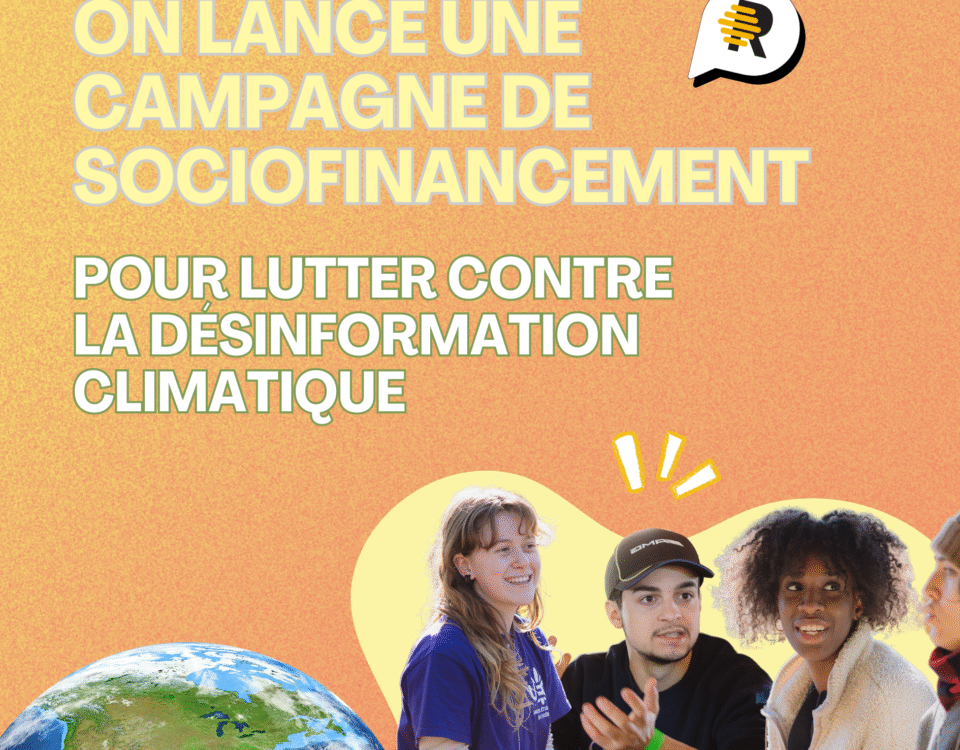Le troc contemporain: échanger sa voiture contre le bien-être de la planète
8 juin 2022
Climate justice: the Supreme Court of Canada dismissed ENvironnement JEUnesse’s application for authorization
28 juillet 2022
Le troc contemporain: échanger sa voiture contre le bien-être de la planète
8 juin 2022
Climate justice: the Supreme Court of Canada dismissed ENvironnement JEUnesse’s application for authorization
28 juillet 2022Chaque hiver, dès les premières baisses de température, Montréal perd une partie de son dynamisme: les bornes de vélos BIXI sont retirées, beaucoup de structures temporaires sont démontées et les grands axes piétonnisés redeviennent de simples routes au trafic infernal. Avec l’arrivée des premières neiges, de nombreuses personnes abandonnent les modes de transport actifs comme la marche ou le vélo, que ce soit pour leurs déplacements quotidiens ou des voyages de longue distance.
Malgré le froid et la neige, quelques téméraires comme Guillaume Rivest se donnent le défi de parcourir de longues distances… sans voiture. Certes, se déplacer dans la neige est une rude épreuve, mais ce guide en plein air et journaliste de Radio-Canada a décidé d’embrasser la neige plutôt que de se battre contre elle. C’est donc en ski de fond que le sportif a parcouru le Québec, de Rouyn-Noranda à Montréal.
Une épopée en ski de fond
Dans différentes entrevues, Guillaume Rivest explique son initiative de traverser une partie du Québec en ski de fond par la recherche d’inattendu, par le goût de sortir de sa zone de confort ainsi que par l’envie de marquer dans son esprit les paysages québécois (Brassard et Desrochers, 2020; Limage, 2022; Stab, 2022). Baroudeur dans l’âme, il décide de partir seul et d’apporter toutes ses provisions afin d’être totalement autonome durant le mois du voyage.
Pour ce périple, il est suivi de près par ses collègues de la radio nationale, notamment dans l’émission Moteur de Recherche. Le 3 mars 2022, après avoir parcouru près de 500 kilomètres en direction sud depuis Rouyn-Noranda, il note la diversité de paysages observés ainsi que l’urbanisation du territoire à mesure qu’il s’approche de Montréal (Dugal, 2022). Skiant tantôt dans la forêt, tantôt sur le bord de l’autoroute, Guillaume Rivest insiste sur un point: la difficulté de se frayer des chemins en ski de fond. Bien que quelques pistes et centres de ski de fond existent dans la grande région de Montréal, il constate sans hésitation que le Québec manque d’infrastructures pour les personnes pratiquant le ski de fond. Le chroniqueur a même dû abandonner ses skis sur certains passages.
Guillaume Rivest explique cela par plusieurs éléments. Premièrement, les quelques axes qui relient certaines villes, comme le parc linéaire des Basses-Laurentides qui relie Saint-Jérôme et Montréal, sont en grande partie réservés aux motoneigistes. Cela pourrait paraître contradictoire lorsque l’on sait que l’axe Saint-Jérôme–Montréal est réservé aux personnes piétonnes et cyclistes une fois l’été venu. L’hiver, cet axe est exclusivement réservé aux moyens de transports motorisés, et les personnes fondeuses n’ont d’autre choix que de skier en dehors de la piste.
Deuxièmement, Guillaume Rivest déplore le manque d’infrastructures pour les déplacements hivernaux en plein air. Il critique l’aménagement du territoire québécois en rapport avec les conditions climatiques. Outre les travaux de construction qui ne peuvent pas toujours être faits en hiver, les infrastructures doivent être pensées pour résister saison après saison. Ces raisons représentent de réels défis pour les municipalités.
L’aménagement du territoire en climat nordique
Ces constats permettent à Guillaume Rivest d’ouvrir une réflexion sur la relation entre les infrastructures et le climat nordique. Comment réfléchir le rapport entre la mobilité et l’hiver au Québec? Guillaume Rivest propose de regarder nos cousins en matière de climat, les pays nordiques européens, sous l’angle de la notion de nordicité.
La nordicité est une notion d’origine québécoise qui prend ses racines dans les travaux de Louis-Edmond Hamelin. Ce chercheur aborde l’hiver comme «une saison, mais aussi comme une émotion et un espace» (Hamelin, 1999). C’est donc une notion physique, mais aussi psychologique. Elle est la porte d’entrée vers une vision de l’hiver comme une saison agréable pleine d’occasions, et non comme une contrainte météorologique et climatique. Ce concept s’appuie sur l’observation des pays nordiques et leur approche en harmonie avec les saisons.
L’aspect de la nordicité qui nous intéresse ici est celui de la mobilité. Il ne s’agit plus d’essayer de combattre la neige, le gel et les températures négatives, mais bien de trouver des solutions pour mieux les vivre. Prenons comme exemple la Norvège. Le pays, connu pour son indice élevé de satisfaction de vie (Ortiz-Ospina et Roser, 2013) et son taux d’émissions de gaz à effet serre par personne plus bas que celui du Canada (Ritchie et coll., 2020), semble embrasser sa nordicité bien plus que le Québec. Comment expliquer que la mobilité durable soit conjugable avec nordicité en Norvège tandis que 35% des déplacements dans la région de Montréal se font encore en voiture, même sur de courtes distances (ARTM, 2018)?
Comment bougent les populations osloïte et montréalaise?
La ville d’Oslo, capitale de la Norvège, est un très bon exemple pour cette réflexion. Connue comme une des capitales «vertes», elle ne cesse, depuis quelques années, de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre via diverses solutions (Sustainable Europe, 2019). Que ce soit grâce à un réseau de transports en commun grandissant ou à une proportion de voitures électriques de plus en plus importante, la ville d’Oslo ne ménage pas ses efforts pour devenir plus écoresponsable (Ville d’Oslo, n.d.). Les statistiques sont frappantes: deux voyages quotidiens osloïtes sur trois sont respectueux de l’environnement (Ville d’Oslo, 2018). La répartition est la suivante: 27% de la population marche, 34% utilisent les transports en commun et 6%, le vélo. La part restante, 27%, représente les déplacements en voiture (Ville d’Oslo, 2018).
En 2018, à Montréal, les déplacements en voiture représentent 8 points de pourcentage de plus qu’à Oslo (ARTM, 2018). La part des voyages effectués en transports en commun est, elle, bien maigre comparée à celle des Osloïtes: elle ne représente que 24% des déplacements. Comment expliquer que la mobilité norvégienne soit plus durable que la mobilité québécoise? C’est justement ce que des personnes chercheuses en nordicité ont essayé de faire.
Oslo: une ville mobile… même en hiver!
Un moyen de transport très utilisé en Norvège est le ski de fond. Aux alentours d’Oslo, plus de 2600 kilomètres de pistes de ski de fond quadrillent le paysage (Visit Oslo, s.d.). Des cabanes sont même installées afin d’offrir des pauses conviviales aux personnes sportives. Les sentiers sont balisés et classés par niveau afin d’offrir autant de possibilités de divertissement que d’occasions pour les prouesses sportives. Ces infrastructures sont entretenues de manière régulière afin de ne pas perdre leur attractivité.
Si le ski de fond et les déplacements propulsés par vos jambes ne vous plaisent pas, les solutions proposées par la ville d’Oslo sont nombreuses et surtout électriques: primes à l’achat d’une voiture électrique, multiplication des stationnements de rechargement gratuits, taxis électriques, covoiturage urbain électrique (Ville d’Oslo, n.d.)…
Les initiatives de la ville d’Oslo que nous venons d’énumérer ouvrent une réflexion sur la possibilité de se déplacer de façon écoresponsable malgré la neige et le froid. Au Québec, le périple en skis de fond de Guillaume Rivest nous ouvre les yeux sur le manque d’infrastructures pour les transports actifs en hiver. Dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, il est urgent que les centres urbains nordiques collaborent afin de trouver des solutions plus actives et durables que les déplacements automobiles.
Références
Autorité régionale de transports métropolitains (ARTM). (2020). Enquête Origine-Destination 2018. Autorité régionale de transports métropolitains. https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2020/06/document-mobilite_EOD_2018.pdf
Brassard, D. et Desrochers, A. (animateurs). (2020, 21 février). Louis-Edmond Hameli, penseur de la nordicité (numéro 295). [épisode tiré d’un balado]. Dans Ça s’explique. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/ohdio/balados/6108/ca-sexplique-balado-info-alexis-de-lancer/455696/hamelin-nordicite-biographie-portrait-archive-voix
Dugal, M. (animateur). (2021, 3 mars). Les infrastructures permettant la mobilité durable. [extrait d’un balado]. Dans Moteur de recherche: Rattrapage du mercredi 2 mars: Ski de fond, mommy brain et empreinte carbone du sirop d’érable. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/chronique/392761/velo-marche-ski-pays-scandinaves-exemple
Hamelin, L-E. (1999). «Espaces touristiques en pays froids.» Téoros 18 (2) 4-9.
Limage, V. (animatrice). (2022, 1 mars). L’expédition de Guillaume Rivest Abitibi-Montréal en ski de fond. [extrait d’un balado]. Dans Ça vaut le retour: Rattrapage du 1 mars. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/segments/entrevue/392607/aventure-600-kilometres-suivi
Ortiz-Ospina, E., et Roser, M. (2013). «Happiness and life satisfaction.» OurWorldInData.org. https://ourworldindata.org/happiness-and-life-satisfaction
Ritchie, H., Roser, M. et Rosado, P. (2020). «CO2 and greenhouse gas emissions.» OurWorldInData.org. https://ourworldindata.org/co2/country/norway
Roch, M-H, (2018). Regard sur la nordicité et les stratégies de villes d’hiver durables. VMR.ca. http://www.vrm.ca/regard-sur-la-nordicite-et-les-strategies-de-villes-dhiver-durables/
Stab, A. (2022, 17 mars). Guillaume Rivest: De l’Abitibi à Montréal à pied et en ski de fond. Espaces. https://www.espaces.ca/articles/actualites/15473-guillaume-rivest-de-labitibi-a-montreal-a-pied-et-en-ski-de-fond
Sustainable Europe (2019, 23 octobre). Oslo European green capital 2019. Sustainable Europe. https://www.sustaineurope.com/oslo-european-green-capital-2019-20191023.html
Ville d’Oslo. (s. d.). Climate statistics. Oslo Kommune. https://www.oslo.kommune.no/politics-and-administration/statistics/environment-status/climate-and-energy-statistics/
Ville d’Oslo. (2018). Travel agent distribution. Oslo Kommune. https://www.oslo.kommune.no/politics-and-administration/statistics/environment-status/travel-agent-distribution/
Visit Oslo. (s. d.). Cross-country skiing in Oslo. Visit Oslo. https://www.visitoslo.com/en/your-oslo/winter/cross-country-skiing/
À propos de cet article
Cet article a été rédigé par Léa Camicas dans le cadre du cours COM2018 – Éléments de relations publiques offert par l’Université de Montréal à l’hiver 2022. Il a été révisé par l’équipe d’ENvironnement JEUnesse.
Crédit photo: Léa Ilardo.